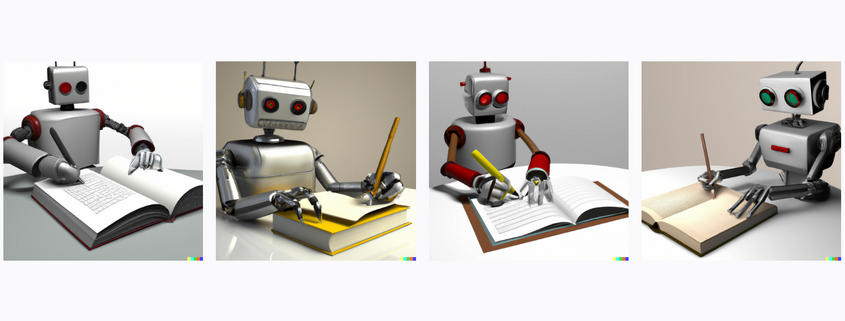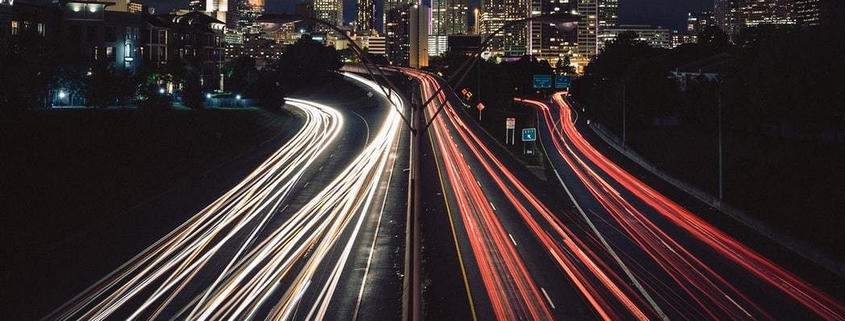Ça y est ! Votre dernière campagne de communication est enfin sortie. Vos publicités occupent les pages de droite de nombreux magazines. Vos posts sociaux commencent à viraliser et vos spots télé à toucher leurs cibles. Félicitations ! On va bientôt parler de votre marque partout.
Partout ? Pas certain… Avez-vous soigné votre communication interne autant que votre publicité ? Avez-vous mis en place les actions qu’il faut pour qu’au sein de votre entreprise, on en sache autant sur les nouvelles innovations de celle-ci qu’à l’extérieur ? Avez-vous envisagé de faire de vos équipes les prochains ambassadeurs de vos produits et de vos méthodes ? Au-delà des revues de presse, la communication interne digitale est souvent le parent pauvre de la comm’.
Et pourtant, elle n’est pas plus difficile à déployer qu’un plan média.
Ce qui vous concerne vraiment
Vos équipes ne sont pas des consommateurs comme les autres. Elles connaissent déjà de près votre entreprise, son organisation, son fonctionnement et les ambitions qui l’animent. Mais ce n’est pas pour autant que chacun, au sein de votre groupe, est en courant des dernières actualités de celui-ci.
La coordination entre la communication extérieure et interne est indispensable pour ne pas créer de dissonance chez vos salariés, ce sentiment résultant de la perception d’un message grand public et d’un discours interne incohérents, voire opposés. À chaque moment de communication externe, prenez donc bien le temps de penser à la façon dont vous allez relayer ces mêmes messages en interne. Le lancement d’un produit, d’une innovation, d’un rapprochement avec une autre entreprise est un grand moment qu’il convient de partager dans les meilleures conditions.
Évitez toutefois de céder à la tentation du copier-coller. Encore une fois , vos équipes ne sont pas des consommateurs comme les autres. Alors que le grand public peut se contenter d’une communication axée sur les produits, vos salariés méritent d’en savoir plus. Quelles innovations avez-vous déployées, quelles nouvelles méthodes ont été mises en place, quelles ambitions vous animent ? Choisissez des arguments qui portent et génèrent de la fierté chez vos équipes. Tous ces éléments de communication, vous les connaissez bien. Ils ont fait partie de votre quotidien lors l’élaboration de vos derniers projets. Il ne vous reste qu’à les mettre en forme pour les partager avec tous.
Des formats pratiques
Communiquer en interne, ce n’est pas faire de la publicité. C’est avant tout faire de la pédagogie. Oubliez les formules toutes faites et les claims de votre agence. Ici, ce sont les contenus riches qui sont rois. Riches et pratiques.
Les contenus que vous diffuserez en interne se doivent d’être adaptés aux plateformes de communications disponibles au sein de votre entreprise. Vous disposez d’un intranet très consulté ? Vous pouvez alors vous permettre de partager des contenus riches (des articles, des photos, des vidéos) pour diffuser vos dernières nouvelles. Mais si au contraire votre entreprise communique avant tout par email ou par réseau social interne (Teams, Slack…), privilégiez les contenus courts qui s’insèrent facilement dans les fils de discussion. Pourquoi ne pas développer, par exemple, votre propre bibliothèque de GIFs ? Bien conçus, ils se propageront rapidement entre les différentes équipes et canaux.
Dans tous les cas, ne lésinez pas sur la narration et les explications. Vous en aurez besoin pour que votre communication interne soit réellement utile et performante. Prenez le temps de concevoir votre discours : il y a peut-être des enseignements que vous souhaiteriez partager avec chacun. Il y a sûrement une histoire que vous souhaitez propager. Pensez bien à celle-ci et mettez là en forme de manière ludique et didactique, par exemple via des courtes vidéos en motion-design. Vos messages seront d’autant mieux perçus.
Soignez vos ambassadeurs
S’il y a bien un point sur lequel la communication interne diffère de la publicité, c’est sur le rôle des ambassadeurs. Au sein de l’entreprise, vos équipes sont aussi là pour propager la bonne nouvelle ! Mettez en avant les talents qui ont contribué à votre dernier projet, valorisez-les et montrez, dans chacune de vos communications, le rôle qu’ils ont eu dans celui-ci. On ne réussi rien sans ses équipes, il est normal de valoriser celles-ci.
Mieux encore, faites les témoigner ! Les derniers produits que vous avez créés est le résultats de méthodes innovantes ? Demandez donc aux porteurs de projet en quoi ces méthodes ont changé leur quotidien et ont permis de créer des innovations de meilleurs qualité et plus rapidement. Témoignages écrits, ou mieux : podcasts et interview vidéo, les moyens de mettre en avant vos équipes sont nombreux et ne nécessitent pas toujours des moyens très ambitieux. Encore une fois, c’est le message, le contenu, qui suscitera l’attention et la fierté plus que la créativité ou la réalisation.
Mettre en avant vos équipes et leur permettre d’être transparentes sur le déroulé du projet n’est pas anodin. Cette démarche a vertu d’exemplarité : elle permet de reconnaître le rôle de chacun dans le succès des projets, de valoriser les talents. Et dire clairement à tous que chacun des projets mérite cette mise en lumière.
Bref, votre communication interne mérite autant d’être soignée que votre publicité, simplement parce que vos salariés sont souvent vos premiers ambassadeurs et les acteurs de vos futures réussites !