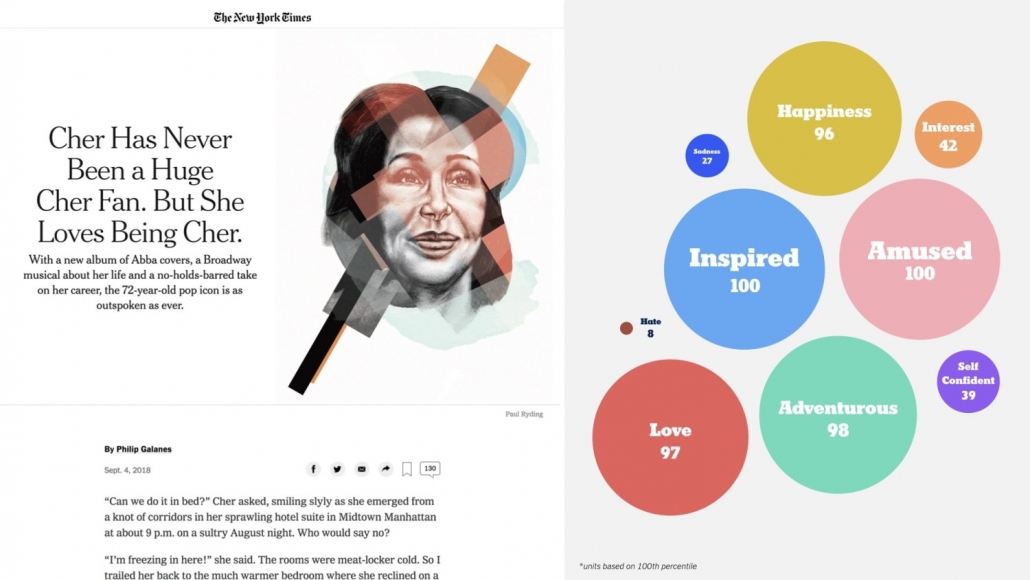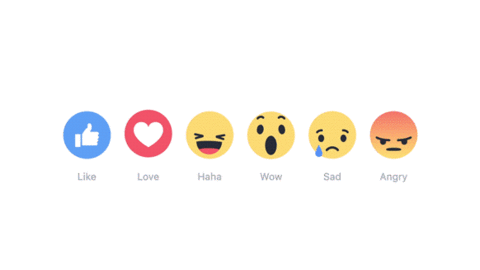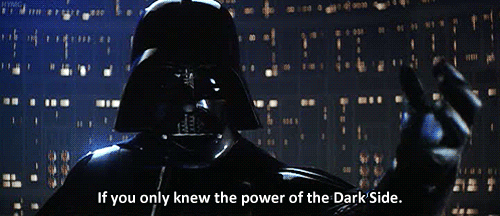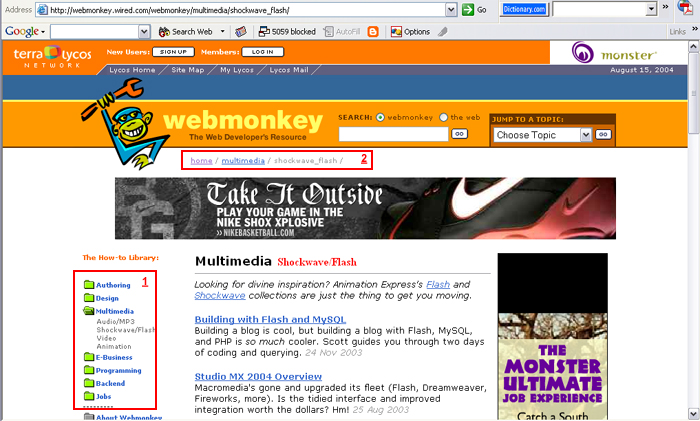Si on devait définir la place du digital en 2018, on serait sans doute bien embarrassé. Alors qu’il y a 15 ans, il y avait un moment et un endroit fixe pour les activités liées à Internet – ces fameuses 15 minutes que nous prenait la réservation d’un billet de train, et ce bureau sur le palier sur lequel était posé un ordinateur dépendant de sa prise électrique et de son modem – aujourd’hui le digital s’en insinué partout dans notre quotidien.

Digital everywhere
Le smartphone est aujourd’hui majoritaire dans nos habitudes d’accès à internet – il représente plus de 50% du temps passé en ligne et plus de 50% des requêtes sur les moteurs de recherche – mais il n’a pas pour autant tué les autres technologies. Nous utilisons toujours un ordinateur quand nous devons accéder à une procédure un peu compliquée – déclarer ses impôts, chercher un voyage… – et nous gardons notre tablette sous le coude quand il s’agit de surfer en regardant la télé ou de profiter d’un site de VoD.
Dans le même temps, de nouveaux usages arrivent. La console de jeu est devenue un mode d’accès à internet à part entière, le temps d’une vidéo sur Twitch ou d’un tuto. Les assistants vocaux commencent à peupler les foyers et répondent à certaines de nos questions… Et plus futuriste encore, nous utilisons parfois une montre connectée pour vérifier nos horaires de train, ou la connexion Internet de notre voiture pour s’assurer de la météo à destination. On n’évoquera pas les frigos connectés, les casques de réalité augmentée, les hologrammes ou les systèmes projetant des écrans sur notre peau…
Les exemples peuvent se multiplier à l’infini, ou presque : Internet est devenu ambiant. Ou est en passe de l’être.
Digital nowhere
Et en devenant ambiant, Internet a tout simplement cessé d’exister. Il s’est évaporé. Le digital a disparu. En tout cas, dans nos têtes.
On redira les chiffres : nous sortons notre smartphone de notre poche près de 150 fois par jour. Notre premier réflexe face à une question est d’interroger Google – à l’écrit ou oralement. Lorsque nous souhaitons un nouveau livre, nous ouvrons l’application Amazon et le commandons en 1 clic – livraison dans la journée garantie grâce à Amazon Prime. Et quand nous nous en ennuyons ? Nous scrollons indéfiniment les statuts de Facebook et les photos d’Instagram.
Il n’y a plus de nouveauté. Il n’y a plus de questionnement. Les outils digitaux se sont fondus dans la foule de réflexes de notre quotidien.
Il est aujourd’hui aussi naturel d’utiliser Spotify quand on souhaite un peu de musique que d’utiliser une fourchette pour manger. La phase de découverte – et le merveilleux qui va avec – s’est achevée il y a quelques années, grâce principalement à l’avènement du smartphone. On ne le dira sans doute jamais assez, c’est la fin de la connexion filaire qui a fait du digital une commodité.
Back to human
Si le digital n’existe plus dans notre quotidien, pourquoi existerait-il encore dans nos stratégies de communication ?
Provocatrice, la question mérite quand même d’être posée avec tout le sérieux possible. A partir du moment ou les cibles de nos plans de communication ne font plus la distinction entre une action concrète et une action digitale, ou un site Web a aussi peu d’impact – sensoriel, imaginaire – que l’exposition à une chaîne de télé, pourquoi ce « monde digital » devrait faire l’objet de précautions ou de stratégies particulières ?
La disparition du digital remet en fait l’humain au cœur de toutes nos réflexions. Plutôt que de se concentrer sur les écrans et les messages qu’on y diffuse, nous avons l’occasion de nous concentrer à nouveau sur l’internaute, le consommateur, l’humain, et sur les habitudes et envies qui l’animent. Cela implique de revoir quelques points dans notre façon de construire les écosystèmes digitaux :
Se concentrer sur les opportunités
Tout d’abord, il convient de se dire enfin que le digital n’est qu’un levier comme un autre. Sans remettre en question les grands principes de l’UX comme les Experience Maps ou les parcours utilisateur – ils ont leur utilité – il convient de les intégrer dans une démarche plus large et plus « humaine ».
Considérer une Experience Map purement digitale est aujourd’hui un leurre. Les interactions humaines mêlent les points de contacts digitaux et les points de contacts concrets : publicité, lectures, conversations, culture générale polluent des « parcours » qu’on imaginerait purement digitaux. Il est donc faux – ou pour le moins réducteur – de dire qu’un process de vente ne se déroule que sur smartphone et ordinateur. Il est le fruit de nombreuses interactions digitales, physiques mais aussi de réactions internes, qu’on ne peut pas toujours anticiper ou modéliser… mais qu’on peut imaginer. Cela n’enlève rien aux vertus de la démarche UX, mais il convient de rester modeste dans son approche.
Ensuite, réfléchir ses actions digitales en « parcours » ou en « tunnels », c’est assumer qu’il y a un objectif. Si un tunnel de conversion a en effet un but, un objectif – celui de réaliser une vente – cet objectif n’en est un que pour le vendeur ou l’annonceur. De son côté, l’internaute n’a peut-être comme raison de sa visite que la recherche d’information, la comparaison d’un prix en vue d’un achat en boutique, voire la curiosité pure. Tous les visiteurs d’un site ne sont pas des clients potentiels.
En réalité, la plupart d’entre nous n’avons pas d’objectifs dans nos usages digitaux.
On discute avec nos amis sur Snapchat pour le plaisir de discuter. On parcourt des sites d’actualité par routine. On regarde les réseaux sociaux parce qu’on s’ennuie… Il serait prétentieux de vouloir trouver une raison à tous nos comportements digitaux, et plus encore une logique dans l’enchaînement de ceux-ci. Nous restons avant tout humains et sommes guidés par notre curiosité, par le hasard… et de plus en plus par les algorithmes ou la présence proéminente de quelques plateformes sociales.
En fait, il faudrait, d’un point de vue macro, abandonner l’idée du parcours pour réfléchir en termes d’opportunités.
Nous ne sommes qu’une somme d’actions
Réfléchir en « opportunités », qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire ne plus partir d’un objectif digital, mais considérer l’humain comme la matière première de toute réflexion stratégique.
Plutôt que d’imaginer les prises de parole possible d’une marque, on va considérer les actions possibles d’un consommateur. Par exemple, quelles actions liées de près ou de loin à la voiture pouvons-nous imaginer pour concevoir l’écosystème digital d’un acteur de l’entretien automobile ? Certaines réponses sont évidentes : l’immatriculation, le contrôle technique, la révision, la réparation occasionnelle… Des opportunités sur lesquelles il est légitime de prendre la parole. Mais des moments plus lointains, au liens plus ténus, existent : le départ en vacances, la consultation d’un site météo, une visite sur les réseaux sociaux.

Cette suite d’actions ou d’intérêts humains, ce sont des « moments de vies » – chronologiques ou non – qui vont servir de matière première à la construction d’un écosystème digital. Pour chacun de ces moments de vie, il convient d’imaginer ce que serait la prise de parole d’une marque sur le digital. Deux exemples :
Sur un moment de vie « commercial », l’approche est simple.
Le renforcement des normes de contrôle technique a provoqué une augmentation de la demande des visites pré-contrôle technique. Effectuer cette visite pour son véhicule, c’est un moment de vie. Comment faire savoir aux consommateurs – pas forcément internautes – que notre enseigne de garage propose cette prestation ? On listera l’ensemble des points de contact sur lesquels un consommateur se rend dans ce contexte et on imaginera simplement les réponses digitales possibles. Ici, c’est apparaître sur les résultats de recherche de Google – en pages Web mais surtout sur Google Maps – ou encore être présent dans les Pages Jaunes quand les futurs clients cherchent une prestation. C’est également exister quand les internautes cherchent des informations précises sur les contraintes du nouveau contrôle technique sur des sites dédiés à l’automobile.
Rien de bien nouveau me direz-vous. Effectivement, la méthodologie des Moments de vie se rapproche ici d’une stratégie classique de media planning. Mais elle provoque des questions, notamment sur le contenu. Ce guide sur le contrôle technique, doit-il être créé de toute part sur le site Web du réseau de garage, ou peut-on se contenter d’une présence sur un site plus généraliste proposant déjà ces contenus ? Il n’y a pas forcément de réponse établie, mais il est important de considérer comme clé de cette réflexion le comportement même de l’internaute. Toutes les stratégies d’Inbound Marketing du monde ne forceront pas un consommateur à consulter un contenu sur votre site si un réflexe est déjà établi chez lui. Ainsi, on aura énormément de mal à détourner quelqu’un qui cherche une recette de cuisine de Marmiton ou de Cuisine AZ…
Partir des moments de vie, c’est accepter que le site Web ne soit plus incontournable dans la communication d’une entreprise, et que parfois les canaux les plus efficaces se trouvent ailleurs, dans la publicité ou dans les partenariats.
Trouver de nouveaux champs d’expression
Un autre exemple ? Le moment de vie « Préparation des vacances » peut-être un très bon axe de prise de parole pour notre garagiste. Près de 50% des Français partent en vacances en voiture, souvent pour le plus long trajet qu’ils réaliseront au cours de l’année.
Quelle réponse apporter ? Ne vous posez pas forcément la question des produits que vous pouvez vendre, mais plutôt des problèmes auxquels les consommateurs peuvent être confrontés.
Un long trajet ? Cela peut-être la crainte de la panne, et donc l’occasion de proposer une révision de son véhicule. C’est l’été et la chaleur, et donc l’occasion de mettre en avant un forfait d’entretien de la climatisation. C’est un long moment enfermé dans la voiture pour les enfants, et donc des activités à trouver.
Autant d’opportunités de communication qui s’offrent à vous et qui sont en rapport direct avec la vie de l’automobiliste.
Reste à trouver les supports sur lesquels votre réponse sera la plus pertinente. La longueur du trajet, elle se ressent avant tout quand un internaute recherche le meilleur itinéraire sur un site de cartographie comme Mappy. L’entretien de la climatisation est lié à la météo et aux conditions climatiques du jour de départ : s’assurer une présence sur Météo France est nécessaire, adapter son discours à la température du jour peut être un plus…

Accepter que le digital n’est pas la réponse à tout
Partir des opportunités de prise de parole, et non pas du rôle de son site web offre un angle de vue inédit sur son écosystème digital. Il permet tout d’abord de réaliser que, même pour les pure-players, le digital n’est pas forcément la réponse à tout.
Il reste forcément des moments d’interaction où consulter un site, interroger un chatbot ou sortir son smartphone n’est pas l’action la plus naturelle envisageable.
Il reste des moments, comme la consommation en grande surface, ou le temps « automobile », où la communication concrète, physique, a bien plus d’impact qu’une quelconque prise de parole sur les réseaux sociaux. Accepter cela, prendre du recul, est nécessaire aujourd’hui pour s’assurer qu’une stratégie digitale est réellement intégrée dans le « réel » et n’est pas seulement une occasion de dépenser de l’argent.
Cette approche permet également d’imaginer des prises de parole inédites, et l’association d’une marque avec des moments de vie auquel on n’aurait pas forcément pensé dans une approche UX. La démarche des opportunités de prise de parole est typiquement une des composantes de la créativité digitale.
Enfin, la somme des réponses aux moments de vie permet de concevoir un embryon d’écosystème digitale. En partant de ces « réponses », on peut cerner le rôle précis de chacun des composants digitaux de son écosystème : à quoi sert le site, à qui s’adresse-t-on sur les réseaux sociaux, qui sont les partenaires potentiels… Il devient alors plus facile de déterminer le rôle unique de chacun et les interactions qui ordonnent ces éléments. Cette vision des rôles et des interactions empêche bien des duplications de contenu – et donc des dépenses inutiles – et permet de mieux cerner le flux de son audience.
L’âge de la maturité numérique
En suivant le comportement réel des consommateurs, on accepte surtout que la transformation digitale fasse enfin son œuvre. S’il a été rêvé il y a quelques années que toute entreprise se devait d’être numérique à 100%, les récents discours et les récentes législation montrent les limites de cette vision « technologiste » de la transformation.
La transformation digitale tient surtout en l’acceptation du fait que le digital est aujourd’hui une normalité aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises.
Il n’est en aucun cas une réponse absolue aux besoins des consommateurs, pas plus qu’un passage obligé pour toutes les prises de parole de l’entreprise. Il réintègre sagement un empilement d’actifs de communication et de leviers de performance, avec ses propres caractéristiques, mais surtout sa propre valeur. En fait, le digital devient adulte.


/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60127399/DSCF3589.0.jpg)